Install Steam
login
|
language
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

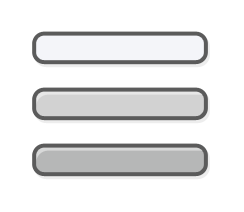












print the page
hand it to your mommy or teacher
receive star for your teacher-parent communication log
erase this or at least remove the tags except french...
It's not anything else than french or have anything to do with even this game.
Maybe you copied it from Wikipedia but it shines a bad light at french gamers.
Also stop applauding a guy who was a big jerk to anyone in europe than french people. I know you're proud of him but he burnt our cities and sent our ancestors to horrible wars.
Merci !
cordialement,
Mausher